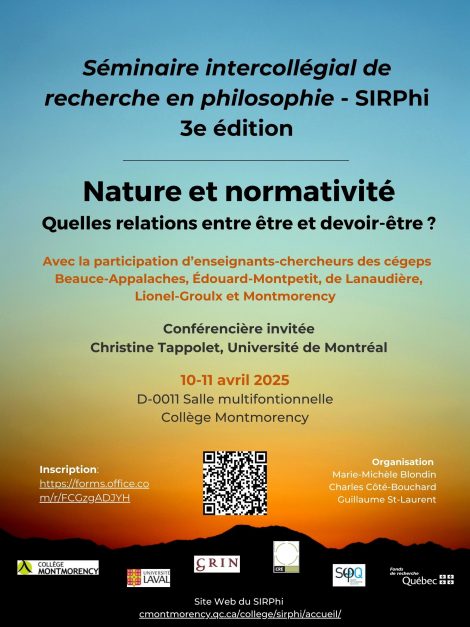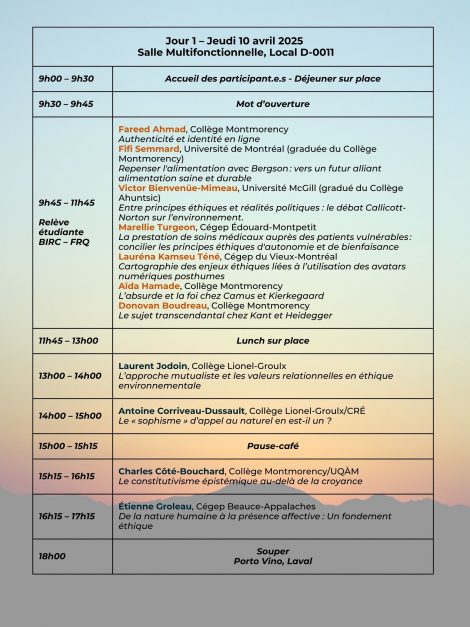Séminaire intercollégial de recherche en philosophie
SIRPhi – Troisième édition – 10-11 avril 2025
Nature et normativité : quelles relations entre être et devoir-être?
Programme:
Pour toute question, contactez-nous à sirphi@cmontmorency.qc.ca
Marie-Michèle Blondin
Charles Côté-Bouchard
Guillaume St-Laurent
Deuxième édition, 11 et 12 janvier 2024
Vie, vécu, vivabilité: la connaissance du vivant et de ses possibilités